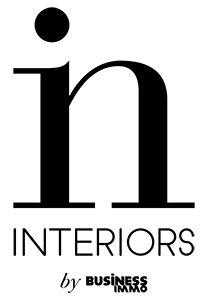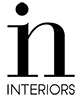La tour, une typologie de bâtiment propice à la qualité de vie au bureau ?
Visuel d’illustration : © Photocreo Bednarek / Adobe Stock
Par-delà l’aménagement, l’ergonomie et la décoration plus ou moins soignés de l’espace de travail, la qualité de vie au bureau passe aussi par la qualité du bâti, dont dépendent pour partie les modes de circulation et de communication. Les tours de bureaux participent de la gestion publique de l’espace urbain puisqu’elles résultent de la recherche d’un équilibre des coûts et des recettes par la valorisation du foncier : les aménageurs « vendent », en quelque sorte, de la tour de bureaux aux collectivités locales en contrepartie d’espaces verts et d’équipements culturels, ce qui n’est pas sans intérêt à une époque où les finances publiques ne sont guère florissantes.
Sortes de « villes dans la ville », les tours de bureaux peuvent aussi, du moins en théorie, faire bénéficier leurs utilisateurs des aspects positifs de la densité urbaine. Mais il faut pour cela jouer à fond la carte de la mixité d’affectation, et concevoir d’emblée de véritables complexes qui conjuguent espaces de bureau, d’habitation et de loisirs, commerces, etc. Autrement dit, comme Le Corbusier, concevoir les tours comme de véritables « machines à vivre et à travailler ».
Par ailleurs, associant la force du signe à la proclamation de la puissance, les skyscrapers, comme les appellent très justement les Anglo-Saxons, écrivent sur le ciel le défi prométhéen de l’homme et le triomphe de sa technique.[1] De la skyline de Manhattan à celle de La Défense, de Francfort ou, plus récemment, de Hong Kong ou de Shanghai, les tours de bureaux sont indissociables des « quartiers d’affaires », de l’ère industrielle au postmodernisme et sans doute bien après…
Pour l’entreprise, la tour de bureaux symbolise, par sa verticalité et la force de son architecture, l’appropriation d’un double pouvoir de domination : celui, politique, du Prince qui est le représentant de Dieu sur terre, et celui, phallique, du mâle qui montre sa force par la puissance de son érection (on dit d’ailleurs « ériger » un bâtiment).
Les simples utilisateurs des tours de bureaux ne se sentent guère, on s’en doute, concernés par le prix du foncier. Ils sont, les études le montrent, déjà plus sensibles au prestige que l’entreprise tire de sa prééminence (au sens propre comme au sens figuré[2]) et à ses retombées sur leur propre image
Le conflit latent entre le dessus et le dessous
Mais c’est sans doute à la morphologie plus ou moins adaptée des espaces et à la fonctionnalité plus ou moins grande des dispositifs de circulation qui concourent à structurer les pratiques de communication (entre la verticalité des ascenseurs et l’horizontalité des cheminements dans les étages) que les salariés jugent leurs tours de bureaux. La topographie de la tour exacerbe le conflit latent entre le « dessus » et le « dessous », le « en-haut » et le « en-bas », qui conduit à considérer les niveaux supérieurs comme plus prestigieux – et ce d’autant plus que l’immeuble domine son environnement.
Pas étonnant donc que, bien au-delà des nécessités fonctionnelles et organisationnelles, les services se battent pour conquérir la position la plus élevée possible dans l’immeuble. Pas étonnant non plus que le dernier étage soit traditionnellement celui des bureaux, des salons et des salles à manger de la direction, qui peut ainsi en imposer un peu plus encore à ses visiteurs en leur offrant une vue panoramique imprenable.
À l’inverse, les étages intermédiaires et inférieurs abritent les collaborateurs plus ou moins lambda, tandis que cantines et salles de réunion, souvent reléguées dans les sous-sols et pauvrement éclairées, ne sont pas sans évoquer un habitat troglodyte à l’usage de travailleurs cavernicoles…
Entre les étages, l’outil de communication quasi exclusif est l’ascenseur (les escaliers n’étant, de facto sinon de jure, que des « issues de secours »). C’est dire si ses caractéristiques (nombre, implantation, capacité, vitesse, étages desservis, etc.) jouent un rôle déterminant dans l’efficacité des liaisons verticales, en particulier en termes de fluidité aux heures de pointe. Et si leur commodité, leur confort, leur éclairage, leur décoration sont déterminants dans le jugement que portent leurs usagers sur leur qualité de vie au travail.
Pour autant, cette primauté de la verticalité ne doit pas faire oublier l’importance des circulations horizontales au sein d’un même étage ou entre deux étages connexes. C’est là qu’une subtile alchimie intervient, qui sublime la géométrie des plateaux (type d’agencement : circulaire, linéaire, radial…) et l’arithmétique de leurs ordres de grandeur (longueur, largeur, profondeur, hauteurs sous plafond…), mais aussi les perspectives, l’éclairage, les points de repère, la signalétique… pour créer, selon le cas et le talent de l’architecte, soit un dédale oppressant de coursives blafardes qui semblent mener à des oubliettes, soit des couloirs lumineux et attrayants qui rendent l’orientation naturelle et l’espace intelligible.
Des points de rencontre où se tisse le lien social
Parmi les éléments structurants, il faut rendre aux cafétérias et autres espaces conviviaux la place qu’ils méritent : dans le budget d’abord, parce qu’ils sont créateurs d’un bien-être qui génère du retour sur investissements ; dans l’espace ensuite, parce que, à l’image du puits ou du lavoir jadis, ils sont des points de rencontre où se tisse le lien social. Nœuds de communication, ils doivent être des carrefours de circulation.[3]
Un mot sur les problèmes de « jour », déjà évoqués à propos des open spaces, et qui se posent ici aussi : plus une tour est massive et plus on y compte de salariés installés près du noyau, donc condamnés à l’éclairage artificiel. Solution : limiter les cloisons pour profiter des « seconds » voire des « troisièmes jours ». D’où des plateaux très vastes, d’où aussi des déambulations gênantes entre les postes de travail et un manque d’intimité, deux inconvénients qui peuvent être atténués par le recours aux cloisons en verre plus ou moins dépoli. Ou, mieux encore, à des « puits de lumière » qui font entrer le jour jusqu’au cœur des bâtiments tout en modelant des volumes intérieurs intéressants.
Citons encore, parmi les facteurs qui accroissent le sentiment d’enfermement, les règles liées aux immeubles de grande hauteur (interdiction d’ouvrir les fenêtres, d’accéder aux terrasses, multiplication des coupe-feux qui cloisonnent l’espace…), les lois antitabac qui contraignent les fumeurs à sortir dans la rue pour griller une cigarette, les portiques de sécurité…
De la Tour de Babel à la flèche des cathédrales, la folie des hauteurs a longtemps traduit la volonté de tutoyer Dieu. Ce n’est que depuis la fin du XIXe siècle que l’invention de l’ascenseur et la mise au point de la construction à armature métallique ont permis à l’architecture verticale d’investir le domaine profane… et de coloniser la planète.
Une logique de concentration. Pourquoi entasser tant de monde ? Si ce choix se justifie à New York ou à Singapour où l’on manque de surfaces constructibles, l’argument de la densité du tissu urbain ne tient pas partout, notamment en France où les tours sont souvent reléguées loin des centres-villes, ni même à La Défense, où elles sont assez éloignées les unes des autres. D’un point de vue environnemental, si l’on est aujourd’hui capable de construire des immeubles de bureaux à énergie positive, la tour est loin d’offrir le meilleur rapport qualité/prix à cet égard.
Communication et espaces verticaux. Les tours sont censées offrir des espaces ouverts favorisant le travail en commun et la communication. Au-delà de la promesse commerciale, on peut se demander si la concentration de population qu’elles induisent favorise réellement les rapports humains. Le moins que l’on puisse dire est que le retour sur expérience de leurs utilisateurs ne va pas massivement dans ce sens…
Le « mal des tours » : mythe ou réalité ? Dans les années 1980, on débattait beaucoup de l’existence de pathologies spécifiques liées à la hauteur des tours, notamment à leur ventilation et leur climatisation. Si les études sont rassurantes sur ce point, on peut continuer à s’interroger sur les effets anxiogènes de l’architecture verticale : malaise lié à l’altitude, à la rupture du contact avec le sol vécue comme un déracinement, à l’environnement aseptisé et contrôlé (air conditionné, impossibilité d’ouvrir les fenêtres…), à la désorientation dans un monde clos et sans horizon où circulation et communication ne tombent plus, littéralement, sous le sens, ou bien, au contraire, où la transparence intérieure et extérieure brouille les repères. À quoi s’ajoute, sur le plan humain et social, l’anonymat, le manque d’intimité, la densité de population parfois vécue comme une promiscuité, etc.
Le fait qu’une tour n’ait qu’une seule issue accroît l’impression d’enfermement. En outre, le traumatisme du 11-Septembre contribue à renforcer le fantasme de la tour infernale. Par ailleurs, il est légitime de s’interroger sur la manière dont les salariés perçoivent les dispositifs de contrôle mis en place pour assurer leur sécurité.
Dans les années 1980, l’architecture de la tour traduisait une hiérarchie affichée et pesante dont, au propre comme au figuré, « les ordres tombaient du ciel ».
Aujourd’hui, on parlerait davantage de standardisation, d’appauvrissement des plateaux, de contraintes liées aux espaces ouverts ou aux nouvelles technologies.[4]
Par Alain d’Iribarne, sociologue du travail et président du conseil scientifique d’Actineo

Alain d’Iribarne © Actineo
[1] Cette forme architecturale est d’ailleurs loin d’être récente. Sans remonter jusqu’à la Tour de Babel ou au donjon des châteaux forts et à la flèche des cathédrales, on peut citer par exemple les 167 maisons-tours de Florence et leurs 72 jumelles de San Gimignano.
[2] « Ma tour est plus haute que la tienne » : on retrouve ici, au pied de la lettre, le symbole phallique.
[3] Voir l’étude pionnière du Centre de recherche en gestion de l’école Polytechnique qui, dans la deuxième moitié des années 1980, avait porté un regard décapant sur « une tour de 50 étages du quartier de La Défense où travaillaient quelque 4 000 personnes », à savoir le siège d’Elf. Voir Jacques Girin, La communication dans une tour de bureaux, Annales des Mines, série « Gérer et Comprendre », n° 9, décembre 1987.
[4] Source : Élisabeth Pellegrin-Genel, architecte et psychologue du travail. Rencontre Actineo « Tours de bureaux, tours infernales ? », 25 mars 2009.