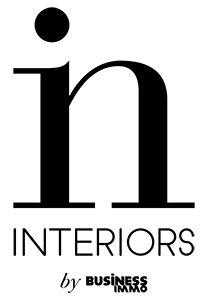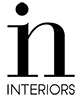« L’habitat ne peut pas résoudre seul les difficultés posées par une dynamique économique qui accroît les disparités sociales »
La période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 amène la lumière sur les enjeux de l’habitat, notamment en Île-de-France, et la résilience de nos modes de vie urbains. Martin Omhovère, urbaniste au sein de l’Institut Paris Région, analyse ces enjeux et esquisse les conséquences que le confinement pourrait avoir sur notre approche de la ville.
in interiors : Selon les données de l’opérateur Orange, près de 1,2 million de personnes ont quitté la région parisienne lors de la mise en place du confinement. Comment analysez-vous ce fait ?
Martin Omhovère : C’est vrai que le nombre de personnes ayant quitté l’Île-de-France pour se confiner en régions pourrait montrer que le territoire francilien se révèle inadapté à ces mesures sanitaires. Mais il faut néanmoins relativiser, car une partie d’entre eux résident en Île-de-France de façon partielle ou temporaire. Ils y viennent pour travailler ou étudier, et ne se sentent pas Franciliens puisque leur famille n’y vit pas. S’ajoute à cela une frange de population aisée qui a la possibilité d’habiter ailleurs pendant le confinement.
À mon sens, la région francilienne a tout de même un certain nombre d’atouts pour endurer un confinement. Tout d’abord, elle dispose d’une infrastructure publique très étoffée et maillée. Le territoire est densément pourvu en services de santé, de commerces, etc. La densité du territoire, parfois vue comme une faiblesse, est selon moi un atout supplémentaire, car elle est favorable à un maintien du lien social. Elle est propice à la solidarité, comme on peut l’observer dans les quartiers populaires, et à l’expression de nouvelles formes de vivre ensemble qui s’expriment dans les applaudissements chaque soir à la fenêtre ou dans des concerts de rue. Enfin, il ne faut pas essentialiser le territoire francilien, qui se compose lui aussi de zones rurales peu denses, qui ont aussi des ressources pour lutter contre les effets néfastes de la distanciation sociale, comme la possibilité de rassembler sa famille proche au sein de sa maison, notamment les personnes qui ne sont pas autonomes.
ii : La crise sanitaire a aussi mis en exergue plusieurs problématiques (SDF, mal-logement, solitude). Pensez-vous qu’elle produira un « déclic » au niveau des territoires et des acteurs du logement pour s’attaquer aux problèmes du logement ?
MO : Effectivement, il ne faut pas laisser penser que tout se passe bien en Île-de-France. La prise en charge des personnes sans domicile fixe ou vivant dans des habitats de fortune est un sujet très prégnant. Pour ces populations, le confinement est une double peine : ils n’ont pas la possibilité de se confiner eux-mêmes et ils ne disposent plus de l’aide au quotidien des personnes qui se déplacent dans les rues. Plus généralement, il faut rappeler que le taux de pauvreté est plus important en Île-de-France qu’au niveau national (16 % contre 15 %). L’État s’est mobilisé pour l’hébergement de ces personnes et pour avancer le versement des aides sociales.
Au sujet de la solitude, il est important de rappeler qu’à l’heure du confinement, c’est aussi un luxe. Nous avons tendance à voir la solitude de manière très négative, mais la possibilité de se couper d’un environnement parfois surpeuplé, très animé, n’est pas offerte à tous, et nombreux sont ceux qui aimeraient l’avoir.
Selon moi, la crise sanitaire met en exergue la diversité des conditions de logement. Près d’un Francilien sur dix est mal logé, 4 % du parc locatif privé est potentiellement indigne, et cela monte à presque 16 % en Seine-Saint-Denis, d’après nos dernières statistiques, 450 000 personnes vivaient dans un logement privé de confort : pas de toilettes ou de salle d’eau dans leur logement, problème de chauffage ou d’eau courante, etc. Ce ne sont pas les constructions nouvelles qui vont changer les choses du jour au lendemain pour les personnes concernées… Gageons que cette période de confinement permettra de mettre la priorité sur le renouvellement et la modernisation du parc existant. Cet enjeu est massif en Île-de-France, même s’il est parfois occulté par la nécessité de continuer à construire des logements neufs.
Source : Institut Paris Région
ii : Quelles sont les axes de solution, alors ?
MO : Pour ce qui est de savoir si la crise sanitaire peut changer radicalement la donne pour l’accès au logement, il faut s’entendre sur ce que cela signifierait. Car une chose est certaine : on observe depuis une bonne dizaine d’années que les acteurs de l’habitat, les collectivités et l’État ont eu une prise de conscience sur la nécessité de relancer la construction en Île-de-France pour répondre à la demande. Il faut poursuivre cet effort, particulièrement en 2020, dans un contexte politique incertain lié aux municipales.
Mais il faut prendre conscience que les coûts d’accès au logement sont tels que les Franciliens ont tendance, de plus en plus, à rester dans le logement qu’ils occupent. Ils sont bloqués par les niveaux de loyers et la croissance des prix immobiliers bien plus rapide que celle des revenus. Tant que les parcours résidentiels ne seront pas plus fluides, les nouvelles constructions seules ne pourront pas améliorer significativement les conditions de logement en Île-de-France. Cela amène à un constat simple : les personnes mal logées n’ont pas les moyens d’accéder à un logement adapté à leurs besoins. On fait peser sur le secteur de l’habitat énormément de responsabilités, mais le problème est bien plus vaste. Il ne peut pas, à lui seul, résoudre les difficultés posées par une dynamique économique métropolitaine qui accroît les disparités sociales.
En outre, ce constat très criant sur la situation du mal-logement appelle une politique ambitieuse sur le parc existant pour améliorer les conditions d’habitat des populations, tout en traitant au passage la question énergétique en améliorant le confort thermique. On voit bien en ce moment que la pollution de gaz à effet de serre a diminué pendant le confinement, mais celle aux particules fines ne baisse pas, car les chauffages résidentiels sont allumés toute la journée et la performance énergétique des bâtiments n’est pas au niveau. Il faut combiner ces trois axes : constructions neuves, rénovation du parc existant et politique de fluidification de la mobilité résidentielle.
ii : On oppose souvent densification et étalement urbain, logements collectifs et résidences pavillonnaires. Cette période de confinement apporte-t-elle de nouveaux arguments ?
MO : On peut distinguer les avantages pour chacun de ces types d’habitats et de formes urbaines. Cependant, pour ma part, je remettrais en question le lien systématique entre densification et logements collectifs d’une part, et étalement urbain et habitat individuel d’autre part. Cette vision est très présente dans les débats qui existent sur la ville, mais elle me semble simplificatrice. On peut densifier sans faire du logement collectif, de même que l’on peut urbaniser de nouveaux espaces sans faire des maisons individuelles – cela fait même partie des objectifs « zéro artificialisation nette » et de la réflexion que nous avons lancée à l’Institut Paris Région.
La période actuelle nous invite à mesurer les qualités d’usages des formes urbaines existantes et à réfléchir à des hybridations. Par exemple, en créant plus d’espaces verts partagés dans les zones d’habitat dit collectif, qui sont un facteur de résilience pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. Concernant l’habitat individuel, la densification est nécessaire pour diminuer le recours à la voiture et développer une offre de services de proximité.
ii : Est-ce finalement au prix de cette résilience que la ville regagnera la confiance des habitants ?
MO : On observe en cette période de confinement que l’équilibre des modes de vie urbains ne tient que lorsque les populations ont la possibilité de sortir de chez elles. Le confinement devient désagréable parce qu’il annule les bénéfices de la vie en ville. Il remet sur le devant de la scène l’importance des aménités urbaines de façon très perceptible : ses espaces publics, bars, restaurants, ses lieux culturels, etc.
La résilience urbaine pose aussi un enjeu social, car elle ne fonctionne que lorsque certaines personnes continuent leur activité : livraisons, commerces, ramassage des ordures, nettoyage des rues, etc. Il faut interroger la place de ces personnes qui se révèlent essentielles actuellement alors qu’elles étaient auparavant assez invisibilisées. Enfin, les grandes métropoles ont trouvé les ressources de leur croissance depuis une trentaine d’années avec le déploiement de la mondialisation. Or, cette crise sanitaire montre aussi toutes les limites de cette organisation très optimisée, à flux tendus et de longue distance. Une organisation très peu résiliente à la défaillance d’un maillon des chaînes de décision et de production. La réinvention de la mondialisation et des modes de production – à laquelle je crois – va probablement changer le rôle de nos villes.
BI : Quelles solutions imaginez-vous pour changer le rôle de la ville ?
MO : Je pense par exemple à des formes de contractualisation entre les territoires. La situation actuelle a poussé l’expression de formes de solidarité entre centres urbains et producteurs locaux. De la même manière, la nécessité de réindustrialiser le pays pour certains produits comme le matériel médical peut se poser de façon plus générale, ce qui générerait des opportunités de développement d’entreprises et d’emplois. Ainsi, les villes s’affirmeraient au carrefour d’une organisation spatiale intégrant les différentes échelles territoriales.